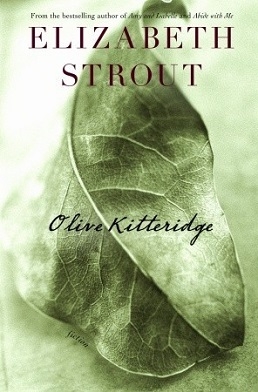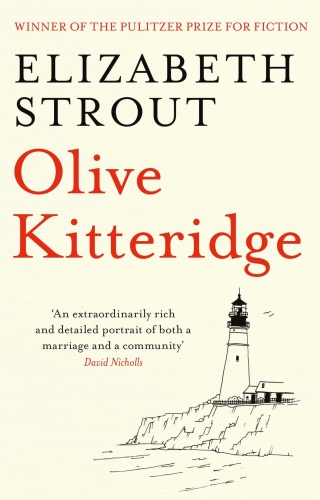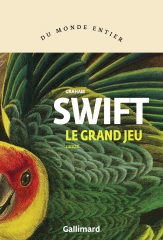Elizabeth Strout a reçu le prix Pulitzer 2009 pour Olive Kitteridge, un roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon. Olive enseigne les mathématiques dans une petite ville côtière du Maine, Crosby, où son mari, Henry Kitteridge, tient la pharmacie. Ils ont un fils, Christopher. Sujette aux sautes d’humeur, grande et toute en rondeurs, Olive ne figure d’abord qu’à l’arrière-plan du récit. Chapitre après chapitre, les diverses facettes de sa personnalité apparaissent en même temps qu’on découvre leur vie de famille et celui de leur voisinage.
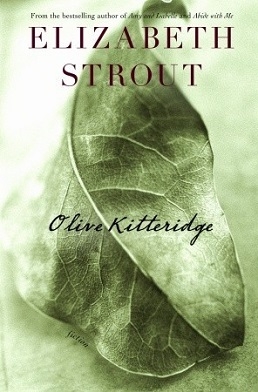
Couverture originale (2008)
La pharmacie est un « refuge paisible » pour Henry, il y oublie « l’état de malaise où le laissait parfois sa femme quand elle quittait leur lit pour errer dans la maison aux heures sombres de la nuit ». Il s’y sent heureux, accueille les clients avec une grande serviabilité. Quand la vendeuse qui tenait la caisse était morte inopinément, il avait engagé Denise, « une souris » selon Olive, une jeune mariée gentille et mignonne aux yeux d’Henry, qui appréciait sa compagnie.
« Mme Kitteridge », comme l’appelle toujours Kevin Coulson qui a été son élève et l’aimait bien, malgré sa sévérité, n’hésite pas à lui parler franchement de la dépression de sa mère quand il revient de New York pour l’enterrer, après qu’elle s’est suicidée. Olive lui confie que son propre père « s’est tiré une balle » et que son fils, devenu podologue, est plutôt dépressif, lui aussi. Ils ne se doutent ni l’un ni l’autre qu’ils vont bientôt devoir venir en aide à une jeune femme tombée en mer à la marée montante.
La romancière relate ce qui arrive à différents personnages proches ou éloignés des Kitteridge, comme la pianiste d’un bar où ils vont parfois prendre un verre ou cette femme d’une autre ville que Christopher épouse et installe dans la jolie maison qu’Olive et Henry avaient conçue eux-mêmes avant d’en construire une autre à quelques kilomètres – « elle a toujours été créative, que ce soit pour coudre des robes, s’occuper des jardins, construire des maisons. »
« Certes, Olive ne pratique aucun sport et son taux de cholestérol explose tous les barèmes. Mais il ne s’agit que d’une excuse, une façon de cacher qu’en réalité c’est son âme qui s’épuise. » D’emblée, elle prend sa belle-fille en grippe, ne comprenant pas que son fils ait épousé une gastro-entérologue. En revanche, elle s’intéresse à une jeune fille anorexique, Nina, qui fréquente avec son petit ami le snack-bar de la marina : « Je ne sais pas qui tu es, jeune fille, mais tu me brises le cœur. »
Si les Kitteridge forment encore un couple, c’est largement grâce à la bienveillance d’Henry, toujours à l’écoute d’Olive et des autres. Elle ne l’accompagne pas à l’office, il n’insiste pas. Quand elle est excessive, il garde son calme. Ils se racontent les potins entendus durant la journée. Malgré le caractère bourru de son épouse, il apprécie leur vie telle qu’elle est.
Olive Kitteridge est au fond un roman sur la vie ordinaire de gens qui se supportent ou non, dans leur vie privée comme dans leur vie sociale. Les événements inattendus auxquels Olive sera confrontée sur une trentaine d’années révéleront sa manière de faire face à ce qui arrive, quoi qu’on pense d’elle. Cette femme sans concession n’a pas la langue en poche – elle ne cesse de surprendre tout au long du récit.
C’est souvent drôle, malgré les drames. Elizabeth Strout a une façon très vivante de camper le décor et de raconter. Les dialogues sont souvent décapants, les comparaisons inattendues. Un exemple : « Un an et demi plus tard, Olive était tellement oppressée par cette histoire que, cramponnée au volant de sa voiture, le visage penché en avant pour percer à travers le pare-brise la faible lueur de l’aube, elle se sentait comme un paquet de café moulu sous vide. »
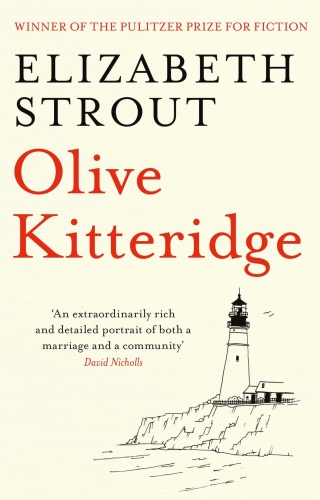
Edition anglaise
Une vie de femme, donc, en treize séquences. Olive Kitteridge n’est pas un portrait psychologique, plutôt un portrait cubiste du personnage, montré selon plusieurs angles. Irritante et féroce parfois dans ses observations, incomprise de son propre fils, Olive continue à s’intéresser aux autres. Elle cache ses failles sous son franc-parler et s’accroche à la vie, qu’elle veut continuer à aimer malgré tout. Le roman a été adapté en mini-série télévisée et Elizabeth Strout lui a donné une suite dans Olive, enfin.
 « Olive comprend pourquoi Chris [son fils] n’a jamais eu beaucoup d’amis. Il lui ressemble sur ce plan, il ne supporte pas les bla-bla. Surtout pour avoir les oreilles qui sifflent dès qu’on leur tourne le dos. Il y a bien longtemps, quand quelqu’un avait laissé devant leur porte un panier rempli de bouse de vache, la mère d’Olive avait dit : « Ne fais jamais confiance aux gens, ma fille. » Cette façon de penser agaçait Henry, mais Henry était agaçant, lui aussi, avec sa naïveté tenace – comme si la vie ressemblait à cette farandole de gens souriants qui s’étalent dans les pages de catalogues de vente par correspondance. »
« Olive comprend pourquoi Chris [son fils] n’a jamais eu beaucoup d’amis. Il lui ressemble sur ce plan, il ne supporte pas les bla-bla. Surtout pour avoir les oreilles qui sifflent dès qu’on leur tourne le dos. Il y a bien longtemps, quand quelqu’un avait laissé devant leur porte un panier rempli de bouse de vache, la mère d’Olive avait dit : « Ne fais jamais confiance aux gens, ma fille. » Cette façon de penser agaçait Henry, mais Henry était agaçant, lui aussi, avec sa naïveté tenace – comme si la vie ressemblait à cette farandole de gens souriants qui s’étalent dans les pages de catalogues de vente par correspondance. »